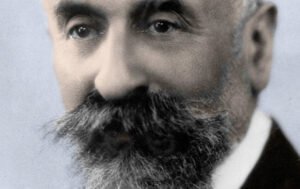En 1925, l’anthropologue et sociologue français Marcel Mauss publie son Essai sur le don dans la revue L’Année sociologique. Qu’apprend-on dans ce texte fondateur de l’analyse des échanges au sein des sociétés humaines ? Mauss identifie trois obligations sociales universelles structurant le don. La première, c’est « donner » : l’obligation de faire des présents, qui établit ou maintient les relations sociales. Le don n’est jamais gratuit mais s’inscrit dans un système d’attentes mutuelles. La deuxième ? « Recevoir » : l’obligation d’accepter les dons offerts. Refuser un don équivaut à refuser la relation sociale elle-même et peut être perçu comme une déclaration d’hostilité. La troisième tient dans le fait de « rendre » : l’obligation de rendre un don, idéalement avec une valeur supérieure. Cette réciprocité différée crée des liens durables entre les groupes. Pour Mauss, le don représente un « fait social total », car il mobilise simultanément toutes les dimensions de la société : économique, juridique, religieuse, esthétique et morale. Il ne s’agit pas seulement d’un échange d’objets, mais d’un système complexe d’obligations structurant l’ensemble des rapports sociaux.
100 ans plus tard, l’application de la théorie du don de Marcel Mauss dans le monde de l’objet média révèle des mécanismes psychosociaux fascinants, qui dépassent largement la simple stratégie marketing. L’objet ou le textile publicitaire s’inscrivent parfaitement dans la première obligation maussienne : donner. Un objet gratuit active immédiatement la logique du don. Ce cadeau n’est jamais neutre : il crée une dette symbolique chez le récipiendaire qui accepte de recevoir. La gratuité apparente masque une attente implicite de réciprocité. L’entreprise « donne » en espérant que le client « rendra » sous forme d’achat, de fidélité ou de recommandation. Cette stratégie exploite le principe anthropologique selon lequel recevoir sans rendre crée un déséquilibre psychologique inconfortable.
Cependant, cette application commerciale de la théorie du don peut créer des tensions. Quand l’intention marchande devient trop évidente, le don perd sa valeur symbolique et peut même générer de la méfiance. C’est le paradoxe de l’objet publicitaire : il doit sembler désintéressé pour être efficace. De plus, la multiplication des objets publicitaires peut créer une fatigue du don, où le récipiendaire se sent manipulé plutôt qu’honoré. L’efficacité dépend alors de la qualité, de l’originalité et de l’utilité réelle de l’objet offert. Les entreprises et les organisations les plus perspicaces développent aujourd’hui des stratégies publicitaires respectant l’esprit originel du don : objets écoresponsables, ultra-personnalisés, liés à des causes sociales, etc. Cette approche apporte une dimension raisonnée, voire éthique, au don commercial et renforce son efficacité en créant un véritable lien de valeurs partagées. Une sorte de Mauss idéal, à la sauce 2025.